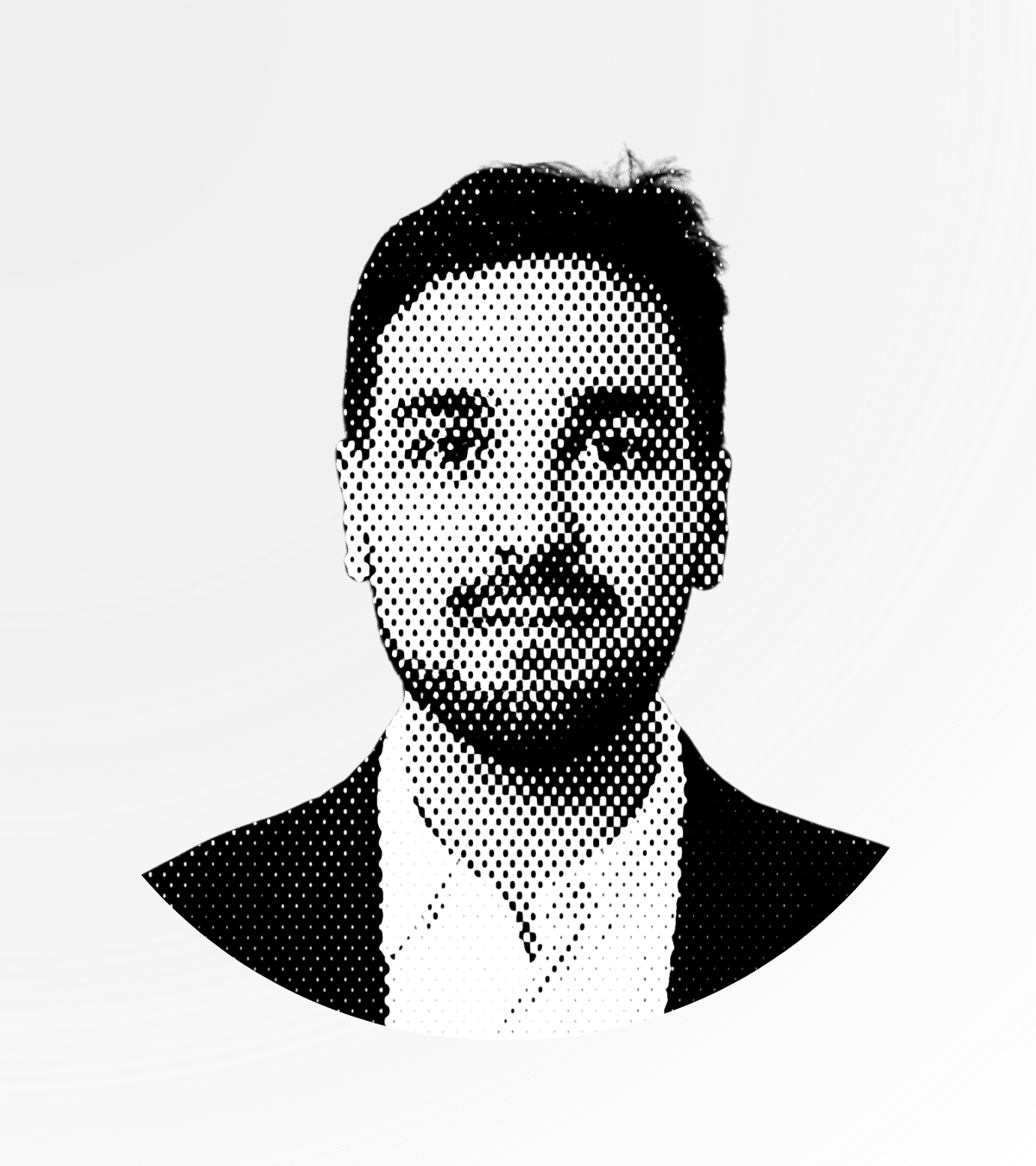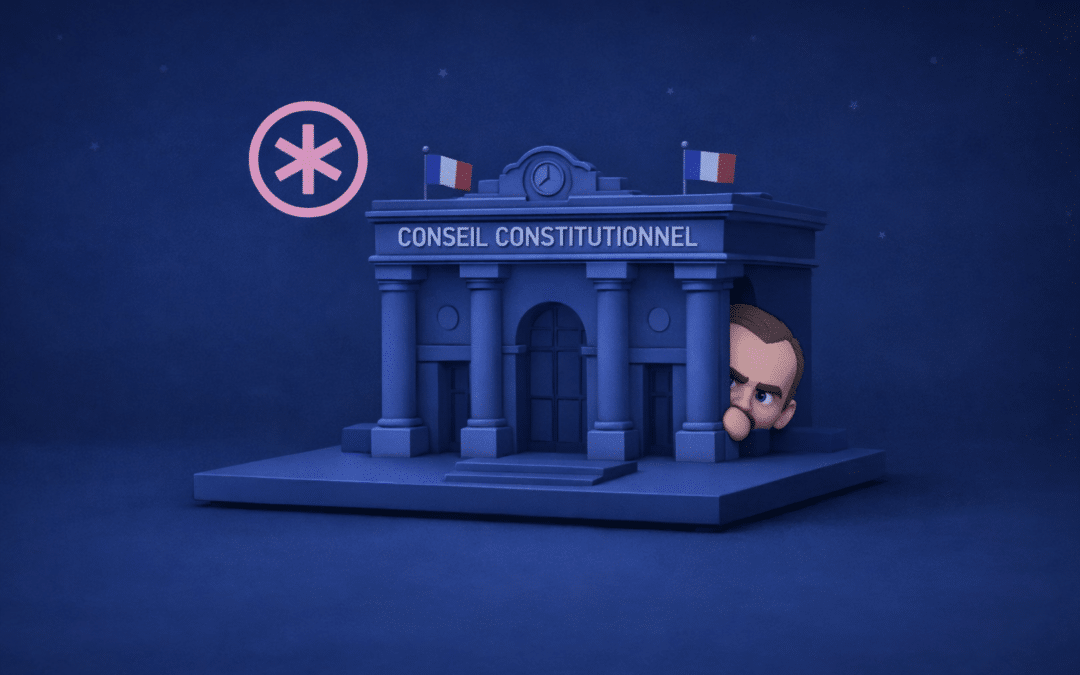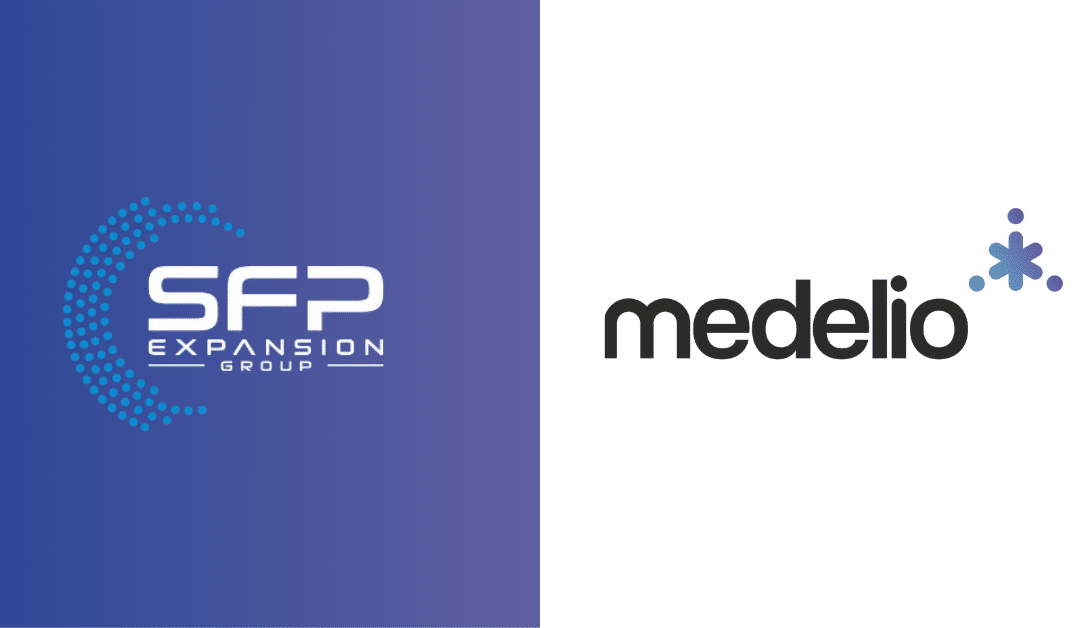En plein débat sur les vols en jet privé de Bernard Arnault ou les résidences énergivores de certains influenceurs, une question revient : à qui parle réellement l’écologie dominante ? Trop souvent, elle a été un projet pour les autres, pensé par ceux qui ont toujours eu les moyens de choisir. Elle s’est construite dans une langue bourgeoise, dans des pratiques exigeantes, dans une morale prescriptive. Le temps vient d’interroger cette posture car pour être juste, l’écologie ne doit pas être une nouvelle forme de distinction sociale — mais un outil de transformation collectif.
Il arrive à chacun de saisir une brèche dans l’agenda, un moment rare entre deux temps pleins, et de faire le choix de partir quelques jours au soleil. Respirer. Sortir un instant du rythme. Pourtant, même ces respirations font l’objet de jugements. Ce n’est pas très écolo. Ce n’est pas très sérieux. Ce n’est pas très « aligné ». Mais aligné avec quoi, exactement ? Et selon quelles normes ?
L’écologie comme posture sociale : quand les gestes verts deviennent des marqueurs de classe
Porter des vêtements véganes, privilégier le vrac, faire ses courses en circuit court, cuisiner bio, limiter l’usage du numérique, rouler en vélo cargo, manger sans viande, voyager lentement… Aucun de ces gestes n’est en soi critiquable. Mais la manière dont ils deviennent un corpus moral, un standard implicite de respectabilité, révèle un problème plus profond : celui d’une écologie qui s’est enfermée dans un entre-soi bourgeois.
Fixer comme horizon une pratique écologique exigeante, propre, cohérente, sans contradictions, revient à rendre la transition inaccessible à celles et ceux qui n’ont pas grandi avec ce capital culturel, ces marges de temps, ces infrastructures. On ne construit pas une écologie de masse avec des codes de classe. On ne fabrique pas une conscience collective à partir de signes distinctifs.
Et qu’on s’entende : il ne s’agit pas de caricaturer ou de disqualifier les choix individuels. Qui n’a jamais vu un ami se faire reprendre pour avoir acheté une bouteille d’eau en plastique ou pris un vol low-cost pour un week-end improvisé ? Ces rappels à l’ordre, souvent lancés avec les meilleures intentions, traduisent parfois une déconnexion profonde avec les réalités sociales. Ce n’est pas le geste qui est en cause, mais la norme implicite qu’il véhicule — une norme qui oublie d’où parlent les gens, et ce qu’ils ont dû franchir pour arriver là où ils sont. Il s’agit de dire que l’écologie, pour être populaire, doit cesser de se présenter comme un passeport pour la vertu. Elle doit parler d’abord aux conditions de vie des gens. Elle doit reconnaître que derrière un « nouveau riche » se cache souvent un ancien pauvre.
Être exigeant avec celles et ceux qui ont le pouvoir d’agir
Il faut être plus exigeant avec ceux qui ont le pouvoir réel d’agir — à titre d’exemple, selon une étude de l’ONG Transport & Environment, les jets privés sont jusqu’à 14 fois plus polluants par passager que les vols commerciaux, et jusqu’à 50 fois plus que les trains. Et pourtant, leur usage reste largement impuni. Ce décalage illustre à quel point les plus pollueurs échappent souvent aux normes qu’on applique au reste de la société. C’est un principe politique de base : on ne pèse pas la même exigence sur une étudiante au RSA que sur un patron du CAC40. Contrôler les jets privés, taxer les yachts, encadrer les hyper-riches : voilà des actes écologiques. Mais dire à un jeune des quartiers qu’il ne devrait pas partir à Barcelone le week-end, c’est de l’hypocrisie sociale.
Cela ne veut pas dire que les pauvres auraient un droit spécifique à polluer. Comme l’a rappelé l’économiste Thomas Piketty dans une tribune de 2022, « les 10 % les plus riches de la planète sont responsables de plus de la moitié des émissions de CO₂ », tandis que les 50 % les plus pauvres n’en produisent que 10 %. Ce constat ne justifie pas l’inaction, mais il oblige à repenser l’échelle du devoir. Le fardeau écologique ne peut pas reposer également sur des trajectoires aussi inégales.
Il ne s’agit donc pas, à mon sens, de défendre un droit à polluer, mais de rétablir une juste exigence dans les responsabilités. Ce n’est ni souhaitable, ni soutenable. Mais cela implique que le devoir d’exemplarité ne peut pas s’exprimer partout de la même manière. Il ne peut pas être aussi impérieux pour ceux qui découvrent à peine certaines libertés que pour ceux qui les accumulent depuis toujours. Il est plus aisé, pour celui ou celle qui a passé son enfance à voyager en famille aux quatre coins du monde, de juger la petite classe moyenne émergente qui choisit de s’acheter la dernière paire de baskets à la mode ou de prendre l’avion pour profiter du soleil à l’autre bout de l’Europe. Il est facile de prêcher la sobriété quand on a grandi entre trois continents. La vertu écolo oublie trop souvent le prix de l’ascension sociale. On ne compte pas le bilan carbone à l’aune des gestes des derniers mois mais bien à l’échelle d’une vie, d’une communauté ou d’une classe sociale.
Tous les bilans carbone ne se valent pas — et tous les gestes non plus
Un trajet en avion, un repas carné, un week-end à l’étranger, un achat neuf : chaque geste est désormais mesuré, commenté, corrigé. Mais tous les gestes ne racontent pas la même histoire. Un déplacement n’a pas la même portée selon qu’il prolonge une vie de confort ou qu’il vient briser un enfermement social.
C’est ce que certains appellent l’ombre climatique : l’idée que l’impact d’un acte ne se mesure pas uniquement à ses émissions, mais aussi à ce qu’il permet socialement, politiquement, humainement. La notion, développée entre autres par l’anthropologue J.-B. Fressoz et prolongée dans les réflexions de Malcom Ferdinand, insiste sur l’importance de contextualiser les gestes écologiques dans des trajectoires de vie. Un vol peut polluer. Mais il peut aussi libérer une existence contrainte, créer un lien familial, rendre possible un horizon de respiration. Un steak peut avoir une empreinte carbone élevée. Mais il peut aussi être un moment de partage, de dignité, de plaisir rare dans une vie saturée de restrictions. L’ombre climatique nous rappelle que les évaluations écologiques ne peuvent pas être réduites à une somme d’émissions — elles doivent intégrer les libertés, les privations, les aspirations, les récits. L’écologie ne peut pas se penser sans lien au réel.
L’écologie doit changer de forme, de ton, de public
Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas de renoncer à l’écologie. C’est de la transformer pour qu’elle parle à toutes les trajectoires, toutes les classes sociales, toutes les cultures. C’est de sortir d’une vision verticale — prescriptive, moralisante — pour construire une pensée politique qui accompagne, qui écoute, qui s’adapte.
Comme l’écrit Malcom Ferdinand, l’écologie dominante oublie l’histoire coloniale, les inégalités structurelles, le passé de dépossession. Elle oublie que les urgences ne se vivent pas partout de la même manière. Françoise Vergès le rappelle à sa façon : à vouloir trop souvent faire la leçon, l’écologie se transforme en outil d’exclusion. Elle dicte au lieu de relier. La vraie transition ne peut pas se construire depuis le haut. Elle se façonne dans les plis du quotidien, dans les contradictions assumées, dans les gestes imparfaits. Elle ne se proclame pas, elle se partage.
À l’heure où les affrontements idéologiques sont forts et qu’ils transcendent la société, l’idée d’une pensée qui ne soit pas prescriptrice mais accompagnatrice est essentiel parce qu’elle est la garantie que la révolution attendue pour le climat sera véritablement soutenue.
Le droit à se déplacer, à respirer, à rêver ne doit pas rester l’apanage des mêmes.