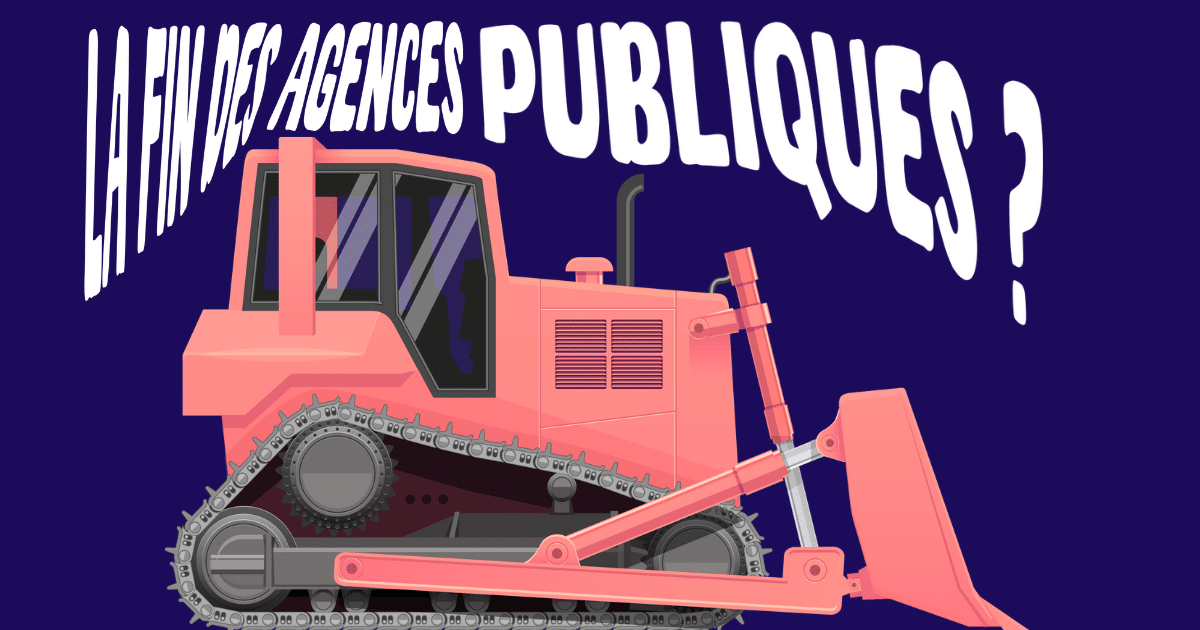Une réforme technique aux répercussions politiques majeures
Sous couvert de rationalisation des dépenses publiques, une réforme discrète mais stratégique est en cours : l’extension de la nomenclature des dépenses publiques consolidées (NDPC). Pilotée par la ministre des Comptes publics dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, cette mesure vise à intégrer davantage d’organismes publics – autorités indépendantes, agences sanitaires, opérateurs sociaux – dans le périmètre comptable de l’État. Dit autrement : ce qui était auparavant considéré comme de la dépense “hors budget” pourrait désormais être réintégré dans le calcul du déficit public et soumis plus directement à l’arbitrage gouvernemental.
La promesse affichée est celle d’une meilleure lisibilité des comptes publics. Mais dans les faits, cette extension ouvre la voie à des fusions, des suppressions ou des remises en cause de l’indépendance de certaines institutions sensibles. L’épisode récent autour du Défenseur des droits, qui aurait pu voir son autonomie institutionnelle remise en cause avant que la majorité ne fasse machine arrière, a agi comme un révélateur. D’autres agences, pourtant essentielles au bon fonctionnement démocratique ou social du pays, pourraient être prochainement concernées par ces logiques budgétaires.
Des institutions dans la ligne de mire
L’extension de la nomenclature des dépenses publiques consolidées touche des entités très diverses par leur statut, leur mission ou leur taille. Certaines sont des autorités indépendantes, d’autres des opérateurs sanitaires, des agences sociales ou des structures de coordination territoriale. Mais toutes partagent un point commun : elles pourraient, à terme, être réintégrées plus fortement dans le giron de l’État, et donc perdre en autonomie ou voir leur existence même remise en question.
Les autorités indépendantes
Les autorités indépendantes sont parmi les premières à susciter l’inquiétude. Le cas du Défenseur des droits a été emblématique. L’idée d’une fusion ou d’une mutualisation avec d’autres institutions du même type – comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou la Commission nationale consultative des droits de l’homme – a été envisagée sous couvert de rationalisation. Cette tentative, avortée à la suite d’un tollé politique et juridique, a révélé combien ces structures, pourtant constitutionnelles ou quasi-constitutionnelles, pouvaient être fragilisées dès lors qu’elles entrent dans une logique purement budgétaire.
Les agences sanitaires
Les agences sanitaires ne sont pas en reste. Santé publique France, par exemple, a été très critiquée pour sa gestion de la pandémie. Depuis, des rapports, notamment de l’IGAS, ont plaidé pour un recentrage de ses missions, jugées parfois floues ou redondantes. L’ANSES, qui intervient sur la sécurité sanitaire de l’alimentation ou de l’environnement, pourrait subir des ajustements similaires, au nom d’une meilleure “cohérence” de l’action publique. Ces agences, techniques et transversales, sont parfois considérées comme trop coûteuses au regard de leur visibilité politique.
Les opérateurs sociaux
Les opérateurs sociaux et ceux du secteur de la formation sont eux aussi particulièrement exposés. L’exemple de France Compétences est parlant : créé pour réguler le financement de la formation professionnelle, elle est aujourd’hui dans le rouge, critiquée pour son opacité financière et sa gouvernance défaillante. La Cour des comptes n’a eu de cesse de pointer ses dérives budgétaires. Dans le même registre, l’AFPA, qui porte historiquement la formation des adultes en reconversion, est en sursis depuis plusieurs années. Déficitaire, restructurée à plusieurs reprises, elle pourrait tout simplement être absorbée ou dissoute.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) constitue un autre cas sensible. Pilier de la politique du grand âge et du handicap, elle se trouve à la croisée des chemins. L’absence de réforme globale du secteur la fragilise, et les projets d’intégration plus étroite à la Sécurité sociale pourraient vider de sa substance son autonomie financière et stratégique.
Les agences de coordination
Enfin, certaines agences de coordination territoriale ou environnementale comme l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires) ou l’ADEME (Agence de la transition écologique) ne sont pas épargnées. L’ANCT souffre d’un positionnement flou, critiqué par la Cour des comptes, qui pointe un manque d’impact et un chevauchement de prérogatives avec les services déconcentrés de l’État. L’ADEME, de son côté, voit régulièrement sa pertinence remise en question dans des rapports sur la transition écologique, certains jugeant ses actions dispersées ou insuffisamment évaluées.
En toile de fond, même les autorités de régulation comme la CNIL, la HATVP ou l’ARCOM sont concernées. Leur indépendance statutaire ne les protège pas totalement des pressions, et le fait que leurs budgets puissent être consolidés dans ceux de l’État pourrait ouvrir la voie à des arbitrages politiques sur leurs ressources ou leurs effectifs.
Comment préserver l’indépendance et l’utilité de ces agences ?
Le risque principal de cette réforme n’est pas uniquement budgétaire. Il est démocratique. Si la puissance publique reprend en main tous les instruments de régulation, de contrôle et de protection, sans garantie d’autonomie, c’est l’équilibre des pouvoirs et la crédibilité de l’État de droit qui en pâtissent. Pour éviter une réduction au silence technocratique, plusieurs leviers existent, principalement du côté des stratégies de communication et d’influence.
Des agences avec une utilité concrète
D’abord, la mise en récit de leur utilité concrète est essentielle. Les agences doivent sortir de leur isolement institutionnel et réaffirmer publiquement leur valeur ajoutée. Cela passe par des campagnes de sensibilisation, des tribunes, des témoignages d’usagers ou d’élus locaux qui bénéficient directement de leurs services. L’exemple du Défenseur des droits est éclairant : c’est en mobilisant des relais associatifs, syndicaux et politiques que l’institution a pu faire obstacle à sa fusion. La narration d’un rôle indispensable dans l’équilibre démocratique s’est révélée plus puissante que les chiffres budgétaires.
Des indicateurs clairs
Ensuite, la production d’indicateurs d’impact clairs et médiatisables est une arme incontournable. Les agences techniques comme l’ADEME ou Santé publique France doivent mieux traduire leurs actions en bénéfices lisibles pour le citoyen ou pour l’État : économies réalisées, prévention de crises, accompagnement des transitions. En montrant que chaque euro investi produit un effet mesurable, elles contrebalancent les logiques purement comptables qui nourrissent leur fragilisation.
Des alliances stratégiques
Autre levier : la création d’alliances stratégiques. Trop souvent, les agences se défendent seules. Mais des coalitions d’intérêt – entre institutions menacées, collectivités locales, experts et société civile – peuvent amplifier les alertes. À l’image de ce qu’a fait la CNIL avec certaines ONG du numérique, ou la HATVP avec les parlementaires sensibles à la transparence, une diplomatie d’influence permet d’inscrire ces structures dans un tissu relationnel qui les protège.
L’importance de la presse et des medias
Enfin, le recours aux médias grand public et non seulement aux circuits institutionnels doit être revalorisé. Certaines agences, comme France Compétences ou l’ANCT, souffrent d’un déficit d’image : elles sont soit invisibles, soit connues uniquement par leurs échecs. Reconstruire une image passe par la présence dans le débat public, des interventions dans les médias généralistes, des formats pédagogiques sur les réseaux sociaux ou des prises de parole assumées de leurs dirigeant·es.
Il ne s’agit pas de céder au populisme ou à la défense corporatiste, mais d’investir pleinement l’espace public pour poser la question suivante : quelles institutions voulons-nous pour assurer les fonctions les plus sensibles de l’État et des droits fondamentaux ? Sans ce déplacement du débat, les agences resteront des variables d’ajustement budgétaire – et donc des cibles faciles.